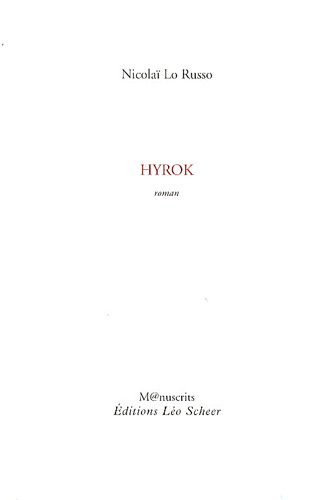J’ai passé une petite dizaine de jours à New-York, ça faisait longtemps. Pour flâner, retrouver le vertige de l’Ouest vertical, le jaune des oeufs, des taxis brouillés, et le turquoise des banquettes en skai. Pour voir, aussi, ce qu’était devenue la « ville-outremonde » depuis que le maire « Rudy sur l’oncle » Giuliani (qui a donné l’impulsion électrique à l’actuel Bloomberg) et le « nine-eleven » sont passés par là. Je n’y étais pas retourné depuis la presque fin du XXe siècle, où planait encore l’ombre poisse de Mean Streets, de Taxi Driver et de toute une flopée de films magnétiques et sanglants.
Je le dis tout de go : New-York est désormais propre et lisse comme une fesse de chérubin. Sacré coup de kärcher, Monsieur le Maire. Bravo. Rien ne dépasse, tout est net, rien ne traîne nulle part. Ni putes, ni mégots, ni soumises, ni papiers gras. C’est nickel vanadium et sans (mauvaises) odeurs. Quelques rares et silencieux homeless quasi propres rasent les murs impeccables, c’est tout. Scorcese doit un peu s’emmerder l’éponge, je me dis. La crasse c’est fini. La « 42 ème » ressemble à l’Avenue Mozart (Paris), le Bronx doit s’apparenter à un arrondissement comme, allez, le dix-neuvième (quoiqu’on égorge encore de temps en temps dans le dix-neuvième, faut faire attention). J’exagère à peine. Non, vraiment, New-York est la cité d’aucun danger, sauf celui d’aller en prison au moindre faux-pas (une sortie matinale de quéquette inopportune par exemple, comme en a fait les frais notre bouillant compatriote…). C’est la « tolérance zéro ». Evry Ouère.
Le vol, aussi, semble avoir disparu des radars. Nous restâmes sidérés, ma compagne et moi, devant le spectacle stupéfiant d’un ordinateur portatif trônant seul et fier sur la table d’une terrasse ensoleillée, en pleine rue ; son propriétaire étant parti répondre à quelques nécessités organiques, une bonne dizaine de minutes. (Faites le test à Paris sur les Grands Boulevards ; laissez votre iPhone sur une chaise, sur une table de bistro, sans surveillance…) Bon, c’est vrai que la ville est hérissée de caméras, et qu’il y a autant de policiers dans les rues de New-York que de pigeons sur les trottoirs parisiens. Ça dissuade.
No smoking. Depuis cet été, outre les terrasses, il est interdit de fumer dans les parcs et les squares. 75 $ d’amandes salées si un gardien vous voit en allumer une. Direct. En fait il est désormais interdit de fumer partout, sauf dans les rues – où là il est impossible de s’asseoir, car il n’y a de banc… que dans les parcs ! (Une photo rarissime : un petit vieux qui fume sa pipe sur un banc.) Bref, vous fumez debout, sans plaisir, au milieu des passants qui passent et des joggers qui joggent. Ou vous rentrez chez vous si vous avez la chance d’avoir un appartement où la copropriété accepte les fumeurs (ces grands malades). Nous qui étions à l’hôtel, avec des détecteurs de fumée bleue dans tous les coins, même pas en rêve tu sors ta tige. Du coup on fume moins. Ou plus. Central Park est un havre de paix où batifolent écureuils, ratons laveurs, myriades d’oiseaux, cervidés, et même, paraît-il, quelques ours qui seraient revenus (nous n’avons pas eu la chance de les observer). Enfin vive la Nature. Et l’Hygiène.
Comme le New Yorkais ne peut s’asseoir quand et où il le veut, paisiblement, eh bien il court ou il travaille. (Sauf à s’asseoir par terre, rester chez lui, ou passer ses journées dans les parcs – à ce titre, Central Park l’immense, qui comme son nom l’indique avec pertinence est au centre de Manhattan, bénéficie de plus de 9000 bancs, dont une bonne partie est financée par des donateurs-sponsors pour la bagatelle de 7500 $ par banc, avec petite plaquette-dédicace gravée ad’hoc ; oui : le citoyen participe beaucoup à l’agrément de la ville, à la mesure de ses moyens plus ou moins colossaux.) Il court ou il travaille, disais-je. Comme les trottoirs sont larges, il est constant de croiser des joggers en pleine rue, à midi ou à minuit (la ville ne s’arrête jamais), des vieux, des obèses, des mères avec leur poussette (!), tout le monde court en basket. Après quoi on ne sait pas, mais il court. Hop hop hop. One two, one two, one two. On se surprend à accélérer le pas pour être en rythm’&blues. A New York on marche des kilomètres sans s’en apercevoir. Sportif programme. C’est la ville fitness. Bonnes articulations exigées. Semelles épaisses conseillées.
Le New Yorkais pressé bouge beaucoup donc il mange beaucoup. Et tout le temps. Mais pas n’importe quoi. Alternance de mets surgas hypercaloriques, et de jus de fruits-légumes hypervitaminés. Les extrêmes. Nous avons en France les baraques à frites, chez eux c’est, entre autres mais très présentes : les baraques à jus. Pour quelques dollars vous avez un demi-litre de jus de carotte-pamplemousse-persil-framboise (si si !) frais dans la minute papillon. Parfois curieux de goût mais ça fait du bien. Et ça cale. C’est un peu la spécialité là-bas les roulottes-coupe-faim. Une institution. Du traditionnel hot-dog aux jus-cocktails, en passant par les fabuleux yaourts glacés, on ne fait pas cinquante mètres sans croiser de quoi se sustenter le cornet. Sans compter les vitrines de « delis » et autres snacks, qui débordent de viennoiseries extra lourdes et de salades composées (par vous-même). Vous êtes littéralement harcelé de nourriture à tous les coins de rue. D’autant que New-York ne semble pas connaître les « heures de repas » vu que ça turbine jour et nuit. Les restos sont tout le temps pleins. Ça consomme à fond les farines. Fusion-food et tutti quanti. Burp.
Ce qui surpend dès l’arrivée – ça, ça n’a pas changé – c’est le bruit. Le bruit est partout. Le métro ferraille, les sirènes hurlent, les climatiseurs mugissent, les rues grouillent d’humains qui vocifèrent dans toutes les langues. Pour le touriste c’est juste un cap à passer ; il finit par s’habituer au niveau sonore. Mais pour le résident, l’organisme, meurtri, à dû s’adapter. De génération en génération le conduit auditif s’est durci et le volume de la voix a dû s’élever et surtout modifier sa fréquence. Ainsi le New Yorkais, par trop volubile (c’est fou ce qu’ils parlent, comme dans les téléfilms), est nasillard de naissance, et on l’entend bien en toute circonstance, sa voix se détache. Hélas, c’est particulièrement insupportable chez les jeunes femmes qui papotent entre elles (et même les moins jeunes) : fermez les yeux, vous croyez entendre des sortes de mouettes hystériques, peu importe le sujet de la conversation. C’est tout juste si l’on a pas envie de s’approcher muni de quignons de pain, de miettes, voire d’un guide ornithologique… Sur le plan sonore, comparé, on peut dire que Paris est une ville tout à fait morte. Ce qui est reposant.
Le New Yorkais, lui, semble ne jamais se reposer. Avec 9% de chômage au compteur officiel, il TRAVAILLE. Tout le monde travaille, boutique, s’active. C’est étourdissant. Le taylorisme est roi à tous les étages : Vous entrez dans un restaurant, même quelconque, vous avez six à huit personnes à quatre épingles pour s’occuper de vous. La première vous accueille, la seconde vous place, la troisième vous apporte le traditionnel verre d’eau-glaçons (un litre environ), la quatrième vous tend le menu, la cinquième prend la commande et parfois votre pouls, la sixième vous apporte les plats, la septième vous demande si « everything is all right », si vous needez something, si les glaçons ne sont pas trop chauds, etc., la huitième vous soumet l’addition et encaisse. (Etrangement vous devez pousser la porte vous-même pour repartir, c’est pénible.) En tout cas c’est sûr on se sent bien entouré. Tous ces gens travaillent. Ils sont affreusement mal payés, mais grâce à votre généreux « tip » obligatoire (15 à 20% de l’addition, qu’ils se partagent), ça passe. Coup de génie américain (ou new yorkais, plutôt). Evidemment la moitié de ces travailleurs ne sont pas déclarés (il faut savoir que plus de 20% de la population new-yorkaise est sans papiers… et que la police n’a pas le droit de procéder au moindre contrôle d’identité sans raison évidente). Autrement dit : T’as pas de papiers mais tu bosses (et tu fous pas le binz), ça va, tu peux rester ; mais si tu chicanes, si tu sèmes le trouble, c’est dehors manu militari. Exit USA définitivement. On appelle ça éduquer une population, de manière rigide mais sans (trop de) violence. Si tu mérites New York tu restes, sinon t’es viré sur le champ (et là c’est pas du coton). Oui, là-bas faut mériter. Ce qui est bien c’est que tout le monde a l’air à peu près satisfait, se sent valorisé, car une situation meilleure est toujours possible. Même si c’est dur. Celui qui a commencé à porter les verres d’eau dans les restos peut finir patron de chaîne s’il bosse bien. Un jour il pourra apporter l’addition, encaisser, ouvrir un resto en face. C’est la compétition sans plafond. Que le meilleur gagne. (Bien sûr ça ne convient pas à tout le monde, ce système. Celui qui n’aime pas travailler, ou ne veux pas, n’a pas de RSA pour survivre, pas d’aide, rien ; il peut suivre une formation payée par la ville. Ou décamper, allez ouste. En fait on lui laisse le choix. Politique volontariste ; qui de l’extérieur en tout cas semble dynamiser la ville.) En somme, si vous êtes bien portant et travailleur, New York est faite pour vous. Si vous êtes vieux, malade, ou que vous avez un poil dans la main, c’est pas le bon plan. (Il n’est pas rare de se faire conduire par un taxi driver de plus de 70 ans, penché sur son volant mais l’oeil vif : il doit travailler. Encore et encore et encore. S’il veut rester.)
Que vous parliez à un asiatique, à un indo-européen, ou à un afro-ricain, vous avez toujours l’impression de parler à un New Yorkais. C’est assez étonnant cette impression. (Comparé à Paris, par exemple…). Mais en fait c’est tout à fait normal : ils ont la chance d’avoir construit la ville à peu près en même temps. Et ils sont fiers d’être là. Ils n’ont pas de « bled » où retourner, ne sont pas en position transitoire ou provisoire. Ils sont New York, man, point. New life in the new city. Cette force, cette assurance, les rend particulièrement aimables envers les étrangers de passage, qui semblent eux toujours un peu perdus. A New York, le quidam même le plus dénué est incroyablement gentil ; il vous aide, vous conduit, vous indique, vous explique, et ce sans compter ni son temps ni son énergie. Par bienveillance, rarement par calcul (sauf à s’acheter une place au Paradis, comme ils sont très église, ça joue un rôle non négligeable). Sacré contraste avec notre égoïsme de Français plaintifs (qui peut néanmoins se comprendre, vu le désastre social dans lequel on barbote). Prenons-en de la graine, malgré tout. Stay cool.
L’argent. L’argent circule partout. Avec une fluidité inégalée. Tous les moyens de paiements sont acceptés. Tant que c’est de l’argent, le feu est vert. Vous pouvez régler en carte de crédit même au marché aux puces, chez le glacier, le vendeur de salades, dans les taxis, partout, et même pour des sommes dérisoires. Il n’y a pas, nulle part, de « montant minimum autorisé ». Pas de stupide blocage improductif. Money is money, man ! Alors vous lâchez des billets verts à tout bout de champ. Un dollars par-ci, un dollar par-là. Au type qui vous a tenu la porte, à celui qui vous a pressé un jus d’orange avec le sourire (en plus du prix du jus, bien sûr). L’argent à New York, c’est la survie. Take the cash or die. Alors c’est sûr que ça formate un peu l’esprit. Nous, qui avons si peur de l’argent (quand encore on en a), ça nous désarçonne les habitudes. On a un peu de peine au début avec cette distribution permanente de billets verts, on a la main qui hésite. Distribution qui se trouve être tout simplement un échange. Sorte de bénévolat rémunéré. C’est vrai que ça aide. Et ça marche. $$$.
Dans cette logique, je me suis demandé aussi comment fonctionnaient les artistes, les peintres, les plasticiens, ce genre. Eh bien pour un nombre grandissant d’entre eux, qui ne sont pas loin des récents « indignés » de Wall Street, on vend désormais dans la rue. A l’emporté. Et sans galerie. Plus besoin. Ils en ont marre de ce passage obligé pour être soit disant crédibles, devoir attendre des années. Fi du parcours institutionnel propre à nos contrées encombrées (et bien gardées). A New York si t’es un bon peintre tu vends. Si t’es mauvais tu vends pas. C’est tout simple. Pas de snobisme ici, ni de castes. La notoriété se construit par les ventes. J’ai discuté avec un type qui avait garé son van dans une rue animée de Greenwich ; il avait disposé ses grandes toiles (plutôt pas mal) le long de son véhicule, en avait posées quelques unes sur le mur, en face. Une mini expo à ciel ouvert. La veille il avait « fait » 7000 dollars. Sans passer ni par une « foire » où il faut payer un rein l’emplacement, ni par rien du tout. « Fuck the gallerists » me disait-il en mangeant une banane. Galeristes qui prennent jusqu’à 70% des ventes, comme chacun sait. Pour le moment, la ville « laisse faire », gratuitement. Si tu fous pas le chnuffzak, que t’es sérieux (et il l’était), ça anime le quartier, bling pop, c’est cool. Ça fait venir les gens, ça fait fonctionner le bu$ine$$. Il y a même des artistes cotés qui viennent parfois exposer et vendre là, sur le trottoir. « Que ça commence à énerver sérieux les intermédiaires… » s’est il enfin esclaffé de son gros rire d’américain fructivore. Il m’a donné sa carte, avec son site internet, tout le tremblement. Un mec très organisé, en costume. Et qui semble vivre dans le confort sa trottoirisation.
(Mais mon Dieu, merde, qu’est-ce qu’on attend, ici en France ? Y en a plein des bons artistes qui crèvent la dalle ; alors que de vulgaires faiseurs tirent les marrons du feu ! Tout est trop codé, trop filouté, trop mou du plexus, ce doit être ça. On a perdu la gagne.)
Heureusement, on a de bons croissants, nous.
Ce billet étant un peu long de l’instestin, je reporte à une autre fois mon désir d’exprimer en ces lignes mon sentiment sur un « giant store » qui m’a particulièrement marqué à New York : M&M’s, le roi de la pastille choco. Du marketing (et du merchandising) à l’américolor, porté à son paroxysme d’efficacité à la vanille. Un must du genre. Il fera l’objet d’un billet au fond du couloir à gauche (sous l’extincteur).
Note : Que le lecteur entende bien avoir lu une vision totalement ajournalistique et subjective de Nouyorque, peu approfondie, partisane ou possiblement exagérée, de ce qui fut pour moi une succession de moments formidables et vibrants, passés avec ma dulcinée dans une ville abyssale et toujours mystérieuse, lors d’un séjour finalement trop bref. Ah oui une chose : Il n’y a pas d’ours vivants à Manhattan autres que ceux magnifiquement conservés dans les inoubliables dioramas du American Museum of Natural History.