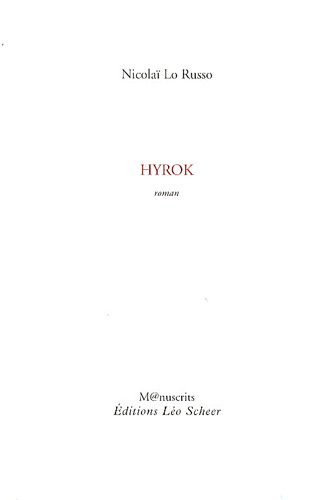CC N.Lo Russo, 2006
Un article ce matin sur Slate.fr m’a replongé dans des reflexions qui me tenaillaient le cortex voilà cinq ans déjà – et qui me hantent toujours – lors de la rédaction de mon roman, HYROK (sorti en 2009 chez Léo Scheer). L’article en question, que voici, parle de cette difficulté à créer de la nouveauté (là il s’agit du domaine de la musique). De la réelle nouveauté. Il y est question de recycling, de remix, de revisiter le passé, de « re re re », on n’en sort pas… L’auteur de l’article fait référence à un livre, « Retromania » (de Simon Reynolds) à sortir le 9 février prochain, où il est exposé la création musicale, surtout depuis le rock, et ses limites dans une perspective historique. Un « passionnant essai ». Je veux bien le croire ; à suivre donc.
Pour ma part, et en forme d’écho rétroactif si j’ose dire, je me propose de mettre ci-dessous un extrait de HYROK (p.352-357) où le narrateur, Louison Rascoli, artiste maudit, résume et commente le mail que lui a envoyé un certain Lucio Badalamenti, sorte de mystérieux expert, mi scientifique, mi critique d’art… Nous sommes là non pas dans la musique, mais dans le monde de « l’image » et de la photographie. Voici :
*****
« Badalamenti maintenant. Ce cher Badal. Il m’a envoyé un mail pour me dire qu’il avait signé un article dans Mathematics & Life ; m’a même joint un fichier pdf. Très aimable j’ai trouvé. Il a dû estimer que j’étais pas totalement abruti. Bon, j’ai pas tout compris, c’est clair, mais en gros ça parle de cette difficulté forcément mathématique à créer de la vraie nouveauté. Problématique qu’on avait du reste abordée dans le train l’autre jour… Il y a quelques croquis dans son article (quinze pages de chiffres, de textes, d’équations…). C’est très parlant cette évolution de l’art pictural en Occident ; à partir de laquelle on peut établir des similitudes dans pas mal de domaines – la littérature, par exemple, ou la musique. Fortement résumé ça donne ceci (en noir, le champ du possible perceptif ) :
Après les dessins préhistoriques au fond des grottes humides, l’art est grosso modo soumis à deux forces : le Bien et le Mal, cette emprise bipolaire de l’Église et du pouvoir royal qui circonscrit les classiques… Fallait surtout pas que ça déborde… Ensuite… siècle des Lumières… influence des philosophes… réveil de l’Individu (il était temps)… On respire… C’est alors au romantisme, au réalisme, enfin à l’impressionnisme de prendre la relève… Puis hop ! on voit débouler l’art moderne début du XXe, avec des courants de plus en plus nombreux, en « isme » : cubisme, fauvisme, constructivisme, futurisme, surréalisme,expressionnisme, j’en passe et des dizaines… Y avait de quoi faire !
Pour aboutir, à l’aube du IIIe millénaire, au « pluralisme » (!) :
Ce qui est remarquable dans ces trois schémas, outre que le dernier me fait penser à une coupe de béton cellulaire (son fameux saut dans le plein…), c’est que le fond noir a, lui, toujours la même taille ; et l’air s’y raréfie considérablement.
C’est donc dans cet espace de liberté que l’art contemporain – entre autres – s’ébroue aujourd’hui et cherche la nouveauté. Chouette ! Faisons des pâtés ! Encore !
Ensuite Badal évoque une représentation fractale de l’histoire de l’art, avec Benoît Mandelbrot et autres illustres matheux… Les branches de l’art comparées à un chou-fleur coupé en deux verticalement, par exemple ; depuis le tronc chaque branche se sépare, puis se sépare encore, et encore, pour aboutir à ces mini-touffes visuellement indifférenciées, à la périphérie du légume… Chaque touffe est un module du tout, le système est complet et autoreproductif, mais dans un système fini : celui du chou-fleur définitif. On n’en sort pas, le champ est borné, semble ne pas avoir de successeur. En fait, selon lui, il faudrait modifier notre perception, faire évoluer nos valeurs si l’on ne veut pas s’écraser dans le Big Wall, le grand mur. Badal prétend que la notion d’individu a vécu (sur le plan de la création en tout cas) et que les temps futurs ne seront véritablement novateurs qu’à l’aide de la supra-intelligence collective. D’où ses théories sur les réseaux, les fragmentations synergiques, les bases de données, etc. À mon humble avis, ce sera un passage difficile avec tous ces ego ! Dont le mien, je l’avoue derechef. Sans compter qu’il y aurait un nouveau modèle économique à inventer. Son papier se termine avec cette surprenante vue 3D [cf. Image couleur ouvrant ce billet] qui étrangement me fait repenser à la fleur qu’il avait tatouée sur la partie interne de son avant-bras : une sorte de liseron. Surface qui ne cesse de croître et qui représente la totalité de la création artistique, soit « le nombre d’idées réalisées » ; la sensation de changement (axe vertical) étant de plus en plus faible à mesure que le temps passe et que l’on « sort de la fleur » en se rapprochant – sans jamais l’atteindre – du double axe orthonormé de l’espace-temps (plan horizontal du « Big Wall »).
Badal précise qu’il faut évidemment considérer cette surface exponentielle comme non lisse. Elle est parsemée çà et là de rares petits soubresauts, de « micro-révolutions ». De traces d’espoir. Mais dans l’ensemble – et dans une perspective historique – c’est cette forme évasée qui doit hélas être retenue.
Si j’en crois le domaine que je connais le mieux, la photo, cette approche, « plastique » si l’on peut dire, me semble particulièrement pertinente : malgré le nombre colossal de photographies produites (plusieurs dizaines de millions par seconde, depuis le numérique) il n’y a actuellement rien de résolument nouveau, contrairement au début du siècle dernier où le champ du possible était encore très vaste. Le futur d’alors était une réalité, un appel à l’exploration. Qu’on en juge : après les longs temps de pose « à la chambre », on allait bientôt pouvoir figer le mouvement au 1/125e grâce à l’invention du Leica ; photographier le sport par exemple ; partir en avion pour aller faire des reportages animaliers – ou photographier des filles dans les îles ! – ; faire sortir la mode du studio, etc. C’était tout à fait inédit. La photographie changeait de décennie en décennie. On projetait même d’en faire sur la lune ! On embrassait tous les possibles avec une sorte de voracité chaque fois renouvelée. C’était la « grande époque » (qu’a vécue Badal). Et que dire des reporters de guerre ? Capa, Nachtwey, McCullin, tous ces courageux qui partaient au front ! Des images pareilles ! On avait jamais vu ça ! Maintenant les photographes qui couvrent les conflits sont sans doute tout aussi courageux, mais leurs images nous font moins d’effet : au visuel, rien ne ressemble plus à une guerre qu’une autre guerre. Terrible banalisation de l’horreur. Alors on ajoute du texte. Pour faire passer l’info.
Bref, avant ça évoluait constamment les images ! On était étonné quand on ouvrait un magazine, peu importe lequel. Désormais on baille dans les rédactions. Entre deux tsunamis si possible bien meurtriers. Ou les frasques pédophiles d’un people. Le numérique prend le relais, ok, mais qu’est-ce que ça change à part la vitesse de diffusion ? Pas grand-chose : on n’est toujours que sur une image à deux dimensions… C’est juste un petit hoquet. Aujourd’hui, bien sûr, toutes les photographies sont différentes ; mais pas neuves. Elles ne le sont plus. C’est fini. Sémiotiquement on arrive au bout, les carottes sont cuites. Et je crains qu’en effet ce soit irrévocable. Au Mikado, chaque jet est nouveau, unique, mais l’image du résultat sur la table est globalement la même. L’« esthétique nouvelle » se fait rare, dans ces conditions. Comme dit Badal, on ne peut guère que recommencer. Donner l’illusion de la nouveauté. Tel ce shampooing aux oeufs « de poules du Mexique » que j’ai vu l’autre jour.
De la même façon, ces « nouveaux maîtres du thriller », qui chaque été embobinent la vacancière « avec une rare maîtrise ». Ou ces « nouveaux talents de la chanson française », qui ont à peine chanté trois notes qu’ils sont remplacés par les « nouveaux » suivants. Et ça continue. Ça inonde les médias. Leurs jolis visages se confondent. Ça déboule de partout. On suffoque. On plie sous la quantité invraisemblable de nouveautés, de « jeunes espoirs ». Je ne peux qu’être affligé et triste devant cet épineux constat. Et m’interroger. Comment les générations de demain vont-elles se défaire de cette cruelle évidence mathématique ? Vont-elles, pour innover, aller chanter, écrire ou faire des photos dans un autre espace-temps ? Créer un nouveau « champ du possible perceptif » ? Par quelle astuce ? quel miracle génétique ? Que feront les cuisiniers du futur, une fois qu’ils auront « inventé » la « nouvelle world food moléculaire » ? Nous implanter une nouvelle race de papilles gustatives ? Nous faire manger des cailloux ? Tant de questions qui restent pour ma part sans réponse à cet instant.
Ou alors est-ce le mot « nouveau » lui-même qu’il faut interroger, soumettre à la « question » ? Qu’il avoue enfin n’être qu’un vieux filou masqué, un vieux brigand à l’haleine fourbe… Quoi qu’il en soit il m’apparaît clair que la société d’hyperconsommation va devoir très rapidement se poser la question de la société de l’hyperdéchet. Déchet humain compris, évidemment. J’espère que les spécialistes sont à l’établi parce que je vois un sacré boulot s’accumuler…
De manière plus générale, quand il laisse la question du neuf pour celle, plus essentielle peut-être, du progrès, Badal admet qu’il y a incontestablement un réel progrès scientifique (encore heureux !), de véritables avancées. Dans beaucoup de domaines. Mais qu’elles ne sont en dernière analyse qu’un petit groupe d’arbres qui cache une forêt en flammes autrement plus préoccupante. Il insiste sur le fait que tant que l’Homme n’aura pas compris qu’il lui faut atteindre un ordre supérieur de la vie, transcendant, tourné vers la communauté plutôt que vers son nombril et son fric, tant qu’il n’aura pas compris qu’un jour ou l’autre il lui faudra être généreux, accepter le sacrifice – notamment par rapport à la course au profit –, eh bien les progrès technologiques ne feront qu’accélérer son déclin, puis sa disparition : « Il faut se méfier, dit-il, de la notion de progrès – progrès pour qui ? – et tâcher de donner une nouvelle chance à l’utopie marxiste, en quelque sorte la réhabiliter, l’adapter à notre monde devenu fou. Le progrès, c’est très relatif ; ouvrons les yeux avant qu’il ne soit trop tard. » Puis, pour terminer, il renvoie le lecteur à une page du web sur You Tube, présentant une vidéo plutôt comique où un gros bébé épouvanté pleure dans une sorte de landeau propulsé par un moteur de tondeuse : « Is that really necessary ? »
Bon. J’espère juste que ce cher Badal pourra m’aider moi d’une façon ou d’une autre ; j’ai répondu à son mail un peu dans ce sens aussi, mais je crains que son esprit quitte de plus en plus le territoire de l’art et des galeries pour des contrées plus arides, plus scientifiques, plus utiles sans doute. Enfin on verra bien comme je dis toujours ! Sacré Badal ! Déjà pas mal que tu penses à moi ! À la tienne mon gros ! »
(En savoir plus sur HYROK – dont j’ai récupéré les droits –, ici.)