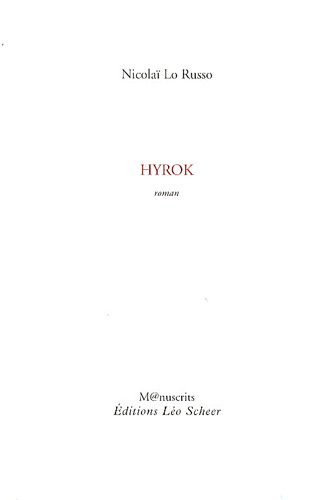Cher Monsieur,
J’ai bien reçu votre courrier du 14 mai dernier qui faisait suite à notre entretien, vous remercie de votre intérêt et de votre confiance.
Débordés comme rarement, c’est avec vigueur et bien navré que je tiens tout d’abord à m’excuser pour cette réponse un peu tardive. Ce qui m’a permis en revanche me pencher personnellement sur les éléments que vous surlignez dans votre missive, questions qui tout comme vous continuent de nous inquiéter aujourd’hui, je puis vous l’affirmer sans détour.
Peut-être les lignes ci-jointes en copie (extrait libre du dossier), matrice mise en forme à l’époque par nos services pour la procédure de contumace, vous aideront-elles dans vos investigations. Que les quelques tournures littéraires et autre cosmétique que vous y trouverez, – ce ton qui peut aider la défense dans sa préparation –, ne vous empêche pas, le cas échéant, de voir ce que vous recherchez pour votre émission – fameuse, et toujours intéressante.
(…)
Me Gaspard de Hauteville, Avocat à la Cour.
*
(…)
Ce 12 septembre 1989, – autant dire il y a un siècle –, quand Pierre Bonnefoy tape pour la première fois « Bo JH TTBM » sur le clavier de son minitel, il entre sans le savoir dans un univers qui finira par l’empoisonner. L’empoisonner et, ce qui n’est pas moins grave, l’emprisonner tout à fait.
Pierre Bonnefoy s’ennuie dans la vie. Il a un travail, marionnettiste, une femme, quelques amis, même un projet d’enfant, mais il s’ennuie ferme. D’autant qu’il présente aux yeux d’autrui le profil type de « l’homme moyen » tel que certains le conçoivent encore, avec une once de mépris bourgeois. L’homme incolore, avec son court mètre soixante-douze, son visage mou de poupon craintif, et, pour entrer comme il faut dans le tableau, son début d’alopécie et sa propension à la transpiration excessive. Or s’il est une chose que Pierre Bonnefoy redoute avant tout, c’est, paradoxalement, la mollesse palote de l’existence. Le train-train quotidien, sans aspérité aucune, sans chemin qui s’enfonce, sans mystère qui happe, sans excitation particulière. Sa jeunesse festive et protégée à Neuilly ne l’a pas habitué, encore moins préparé, à la grisaille commune des jours. On arguerait pourtant qu’un projet d’enfant est quelque chose de lumineux, qui risque de déboucher sur des joies longues ; qu’on va oublier son petit nombril d’intermittent du spectacle un temps, mais non : Pierre Bonnefoy n’en a cure ; il ne peut que se résoudre à admettre qu’il s’ennuie trop souvent ; c’est comme ça, c’est son sentiment. Ce qui le chagrine, surtout, faut-il le redire, c’est son aspect physique ; on le regarde fort peu : il eut préféré de loin être plus grand, plus beau, globalement mieux bâti, plus viril aussi, plus résistant ; mais la nature, sans avoir été cruelle, ne l’a doté que moyennement des atours du corps ; le minimum vital en somme ; charpente, cœur, poumons, et sang, pour faire bref. Ce qui, nous allons le voir, est un peu juste, pour les ambitions démesurément sensuelles de Pierre Bonnefoy – que ses marionnettes ne peuvent absorber.
« Bo JH TTBM », donc. Le pseudo brille de son éclat le plus vif sur l’écran de pixels ; intrigue, en ce tout début d’époque des « réseaux sociaux ». Et puis ça n’est pas rien « TTBM », sigle emprunté aux codes gays naissants ; « très très bien membré », ça attise sacrément ; le truc hors norme, la puissance vitale qui fait tant défaut à Pierre Bonnefoy. Lui soudain en Apollon-étalon ! pectoraux, abdominaux, barre à mine à mi-hauteur. Magnifique avatar ! Dieu grec, mesdames et messieurs les jurés ! Au travers duquel il conversera longuement, fièrement, avec « Corinne mariée », « Julia 95C », « Couple pour trio », voire même « Bruno bonne suceuse », sources inépuisables d’excitation, de dialogues salaces et prometteurs qui parfois l’emmèneront jusqu à tard dans la nuit, sexe en main, en transe, alors que sa femme Sophie dort. Ou qu’elle ne dort pas.
Dans la vie tristement pâle de Pierre Bonnefoy, cette découverte qu’on peut s’inventer vite fait une identité en kit – fut-elle fallacieuse – va s’avérer d’abord providentielle, quoique ce jeu de rôles, comme on pourrait le définir sans pousser trop l’analyse, n’occasionnera aucune rencontre véritable. (Plus besoin de rencontrer d’ailleurs : le tchat, comme chacun sait, permet d’obtenir une distance si proche – curieux oxymore -, si tactile, qu’il est devenu tout à fait décevant et superflu de rencontrer qui que ce soit ; d’autant plus quand, comme dans le cas de Pierre Bonnefoy, il y aurait clairement « tromperie sur la marchandise ».) Providentielle découverte, disais-je, car cette forme de schizophrénie virtuelle et délibérée, contrôlée au début, va se trouver comme porteuse d’une vie augmentée, annonciatrice d’un espace de plus à parcourir (assis, devant la peau si douce de l’écran), d’un champ sensoriel nouveau à investir ; il serait trivial et taquin d’affirmer qu’elle invite à une Second Life (ici, essentiellement sexuelle). En tout cas à une other life. Ce qui ne connaît aucun précédent dans l’histoire des technologies de communication.
Par parenthèse, le cas Bonnefoy n’est pas sur ce plan un cas isolé, loin s’en faut. Des hordes de mâles assoiffés, qui s’ennuient tout autant, l’enquête l’a montré, rejoints bientôt par des grappes de femelles tout aussi seules, vont se retrouver, régulièrement, sur des « sites de rencontres ». (Parfois, d’ailleurs, une rencontre a lieu. Une vraie. Avec, la plupart du temps, étreinte mécanique, expédiée, désillusion à la clé, et retour à la case solitude pour refaire un tour. Mille tours. Myriades de solitudes tout agitées de mouvement brownien, erotico-erratique, c’est très amusant à observer. Moins à vivre, forcément, à la longue.) De nos jours, ces sites se sont perfectionnés, chacun bénéficie d’une « fiche produit » personnelle permettant l’évaluation rapide et réciproque de la marchandise. Il fut un temps, notons-le au passage avant de clore la parenthèse, où le chaland espérait, en s’inscrivant sur ces sites, faire une « vraie rencontre », sérieuse, durable ; surtout sur ceux où le motif de consommation sexuelle était plus sournoisement éludé au niveau fonctionnel. Mais ne nous leurrons pas mesdames et messieurs : dans ce monde du jetable-roi, chacun cherche son chat d’un soir, comme dirait l’autre, comme-ci ou comme ça. Puisqu’on s’ennuie. Puisqu’on doit consommer jusqu’à la mort, abrutis que nous sommes.
(…)
Voilà notre Pierre Bonnefoy rendu en juillet 2006, plus de quinze ans d’expériences virtuelles derrière lui. Il est divorcé, sans enfant, au chômage, fiché pour « détention et diffusion d’images numériques à caractère pédophile », fatigué chronique, sujet à de fréquents maux de tête, accès de torpeur morbide et autres vertiges difficilement supportables. Son généraliste (Dr. Rubinstein) y voit surtout une dépression bien installée, consécutive à une monomanie désocialisante, de type addictif, doublée d’un manque total d’activité physique. Ce que le praticien ne voit pas, en revanche, qui est fondamental et que révèlera plus tard l’expertise psychiatrique, c’est qu’il n’y a plus de Pierre Bonnefoy : Pierre Bonnefoy a quasiment disparu. Il y a bien son patronyme sur sa carte de sécu, sur tous ses papiers, sur sa boîte aux lettres remplie des courriers qu’il reçoit à son nom, il y a bien çà et là de réelles traces d’identité, mais lui, Pierre Bonnefoy, le vrai, l’habile marionnettiste, le mari timide et effacé, n’existe plus. Il s’est dissout, liquéfié ; ou plus exactement il a éclaté en monades identitaires multiples, cent fois renouvelées. Pierre Bonnefoy, en homme intelligent et créatif, a été non seulement un jeune homme fortement doté, le « bo jeune homme » des débuts, mais aussi, une « fée des enfants », un « fan de Barbapapa », un « prof de lettres cokin », une « salope à blacks » ; il a été Bobby la gaule, Cul d’or, Lili Pute, Heavy Cock, Hot Psy, Tarzette, China girl, Blanche fesse, Urubu, Penetrator, etc. ; il a rempli des dizaines de fausses fiches, agrémenté ses « pages perso » de photos volées sur le web – portraits, nus –, de renseignements précis et invérifiables sur « lui » (mais lequel ?); il a parcouru des forums en anonyme, des blogs, affublé de pseudos étranges, parfois drôles, ou consternants, ou effarants. Il est resté des heures, des milliers d’heures, hébété, drogué, loin de Pierre Bonnefoy du vrai monde, loin de la vraie vie, s’inventant des destinées, créant des marionnettes inédites, assis devant sa fenêtre magique avec ses masques d’halluciné, aspiré par les courants forts de l’océan bleu, son seul et unique horizon.
Dans ce qu’on entend d’habitude par « monde réel », analogique, Pierre Bonnefoy a fini par totalement inexister. Avant l’incident il ne mangeait plus, ou si peu, si mal, son bureau où il s’est longtemps calfeutré était devenu un indescriptible foutoir, un cloaque aux relents aigres. Sans travail, sans confident véritable, seul dans sa citadelle, il disait pourtant vivre « intensément », échanger avec ses « nombreux amis » MySpace, quand sur ordre de police on est venu le chercher pour l’interner en urgence. Pour « l’écarter du monstre et le mettre à l’abri », rectifie Madame sa mère, éplorée (Lucette B., née Daumier, troisième témoin).
Voici venue l’ère du masque, mesdames et messieurs les jurés, sinistre et redoutable ; cet avènement que permet Internet avec une facilité et une efficacité inégalables, et qui, soyons clairs, ne fait que commencer.
Dépassé par la Machine, avec comme seule boussole sa passion, l’Homme est faible s’il est livré à lui-même. Aussi j’en appellerai à votre clémence, à votre intelligence sensible surtout. Comment ne pas avoir une pensée émue pour Pierre Bonnefoy, ce pauvre homme qui, m’a-t-on signalé lors de ma dernière visite à Sainte-Anne, souffre maintenant d’effrayants délires hallucinatoires. Le service où il se fait soigner reçoit de plus en plus de cas semblablement tourmentés. De plus en plus jeunes. Des « gamers », des « fous de la toile », comme on les appelle. Indépendamment du passage à l’acte qui nous occupe avec Bonnefoy et pour lequel les dernières expertises montrent bien des lacunes, je laisse à votre sagacité le soin de juger combien tout ceci est préoccupant pour la Santé Publique.
(…)
Note NLR : si un brin d’éclairage sur la dimension psychopathologique de cette affaire était jugé nécessaire, le lecteur intéressé pourra notamment se référer au « syndrome de Lerne », curieuse affection décrite dans quelque sombre pli de HYROK, roman social à paraître le 7 octobre 2009 aux éditions Léo Scheer.