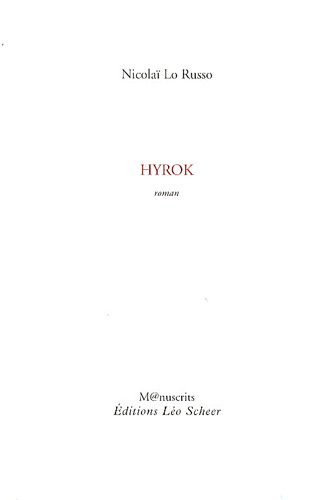Voilà quelques semaines que je traficote mes fioles de matières – j’en ai pour l’heure 150 en comptant un tiers de matières de synthèse –, à la recherche de « nouvelles senteurs » et autres accords inédits. C’est très présomptueux, assez absurde, mais je suis artiste, enfin c’est mon étiquette, alors me voilà pardonné – d’autant que je ne souhaite pas spécialement redevenir parfumeur (je l’ai été sans doute dans une autre vie, mais vous dire laquelle ?). J’explore, c’est tout, je me frotte, je tâte, je joue. Avec tranquillité, plaisir, et l’exactitude que me donne ma balance au millième de gramme. Je savais que la parfumerie était un art difficile, j’ai la certitude désormais que c’est un art… extrêmement difficile (et tant mieux).
Le b-a ba consiste à bâtir des accords dits classiques (chypre, par exemple, construit sur la mousse de chêne et la bergamote) et d’y apporter quelque modulation à l’aide de matières qui s’accordent pour élaborer un jus dont les molécules (dites « de tête, de coeur et de fond ») s’évaporeront progressivement. Tout est dans le choix et le dosage savant de ces matières. C’est un métier. Dix ans d’apprentissage en moyenne, pour celui ou celle qui part vraiment de zéro et veut la ceinture noire en « parfumerie fine ». Et comme partout, les génies sont rares, les places chères, le copinage de rigueur, et les déceptions nombreuses. Voilà pour le décor, le mythe est sauf. Pour plus de détails spécifiques, il vous suffit de taper « parfum » sur l’ami Google, sans lui faire mal si possible, et vous aurez une centaine de milliers de pages de renseignements. C’est un monde vaste.
Qui m’intéresse car il m’éclaire d’une manière que je soupçonnais sur le processus de création et ses analogies avec, par exemple, la musique (j’y viendrai plus bas, ou dans un autre billet si celui-ci s’avère long).
Voyons d’abord, suite de l’article précédent, cette affaire de nouveauté.
L’histoire de la parfumerie, millénaire faut-il le rappeler, compte une dizaine d’accords classiques – c’est peu –, à partir desquels les parfumeurs d’aujourd’hui tentent, pour certains, de réinventer la roue – autrement dit composer le parfum que, à l’instar de feu Jean-Baptiste Grenouille, tout le monde s’arrache. Dur labeur, cent fois sur le métier remis (surtout si les jus sont testés et re-testés, ce qui est commun dans les marques de grands groupes). Les parfumeurs sont évidemment aidés dans cette lourde tâche par une armée de communicateurs, fabricants d’image et autres publicitaires bardés de techniques manipulatoires. (Car c’est VOUS la star.)
Trouver, déjà, un truc qui sente bon, et si possible qui sente nouveau. (Ensuite viendra l’incontournable phase habillage/image dont j’ai parlé dans l’article précédent.)
Qui sente nouveau ?
Alors que, comme je l’ai dit déjà, plus de deux cents mille références existent et sont disponibles, web et magasins. (Imaginez un linéaire chez Untel Shop, avec 200.000 flacons, c’est une façade compacte de 3 mètres sur 100…) Sans compter le nombre vertigineux de parfums non référencés. Il convient, je crois, d’être humble quand on souhaite créer un « nouveau » parfum. Ou fou.
D’aucuns me diront que tout parfum est nouveau. Ils ont raison : il y aura toujours une différence, même infime, avec ceux de la même famille olfactive qui l’auront précédé. Mais il y a fort peu de chance qu’il soit neuf. Car pour qu’il soit neuf – c’est à dire qu’il repousse les limites de l’histoire de la parfumerie, il faudrait qu’il sorte du champ olfactif culturel d’une population donnée, à une époque donnée, en matière de parfums « portables ». Et c’est de plus en plus difficile. Possibilité est donnée, parfois, par les laboratoires qui inventent de nouvelles molécules, ou plus exactement de nouvelles sensations olfactives. Comme la calone (Givaudan), responsable de toute une vague de parfums à l’odeur marine-iodée – alors inédite – qui déferla ad nauseam sur le marché dans les années 90. Dans un premier temps la molécule est dite « captive », c’est à dire qu’elle n’est vendue (avec un petit ®) qu’à une maison de parfums qui en a acheté l’exclusivité – à prix fort évidemment. Une fois que la molécule est « libérée », d’autres maisons en profitent et le marché est inondé de parfums similaires, ne se différenciant que par l’habillage pour la plupart.
Or la découverte de molécules résolument « neuves » est de plus en plus rare. La champ olfactif contemporain se trouve de plus en plus saturé. On ne peut guère qu’affiner, travailler sur le volume ou la diffusion de telle ou telle fragrance, apporter une note un peu différente, etc. Mais inventer véritablement est de plus en plus ardu. Sur 2000 molécules que Givaudan (ou IFF, ou Firmenich, etc.) fabriquent annuellement, deux ou trois maximum sont mises sur le marché. Avec un sentiment de révolution olfactive de plus en plus faible ces dernières années. On dirait que ça se tarit, en tout cas pour le marché « mainstream », la grande distribution. Obligés d’adapter ce qui existe déjà. De ressortir, actualiser des fragrances disparues. « Comme en mode et en musique », noteront certains observateurs taquins.
On peut alors se pencher sur les « marchés de niche », les artisans-parfumeurs, les fous furieux, les indépendants qui se comptent par milliers de marques, voire par dizaines de milliers dans le monde (hé oui, il n’y a pas que Chanel, YSL, Dior, Guerlain, LVMH &Cie dans la parfumerie, holà non). Pour ces valeureux résistants les possibilités sont un peu moins minuscules de faire du neuf. Leur cible est plus restreinte, acquise à leur cause ; ils ne sont pas tenus de vendre leurs flacons par millions à l’International tests à l’appui. Ils peuvent donc tenter. Tenter des fragrances aux facettes intéressantes, parfois à la limite voire au delà. Apporter des notes osées, étranges, extrêmes… voire mono-molécule (type ambroxan) à leur clientèle plus exigeante et généralement mieux informée. Il y a en outre quelques (rares) artistes-nez, anglo-saxons, comme l’américain Christopher Brosius (avec sa ligne « I hate perfumes », non distribuée en France) ou la berlinoise Sissel Tolaas qui s’emploient à capter, traduire en fragrances les odeurs les plus inattendues. On approche alors de l’art conceptuel, parfois du « grand-n’importe-quoi » (encore qu’il faille le définir, tout est question de point de vue). Et il y a des amateurs, de plus en plus nombreux. Ceux qui veulent sortir des senteurs battues, qui cherchent la rareté, qui n’ont pas peur de plonger dans les abymes du souvenir, de croiser des senteurs de câbles d’ascenseur bien gras, de metro aux heures de pointe, parfois même de tombe ou d’hôpital… Après, bon, c’est vrai, il faut pouvoir (et vouloir) les porter. Une autre affaire. En France, pays d’un classicisme parfois consternant, il semblerait que nous ne soyons pas encore prêts. La limite du « supportable » a été la collection Synthetics de Comme des Garçons, déjà jugée par trop conceptuelle (odeurs de garage, notes kérosène, plastique brûlé, ce genre). Chez Colette ça passe. Chez Séphora beaucoup moins…
Notons que c’est là, bien souvent, que le « discours-produit » et le travail pointu sur l’image et le contexte prennent tout leur sens pour venir aider une fragrance « étonnante » (c’est une litote) à sortir du flacon – et de l’ombre où elle resterait sans quoi hermétiquement confinée. Pas évident de faire évoluer les mentalités et l’on ne peut guère avancer plus vite que la musique. C’est pourtant bien le rôle de l’artiste ! (Encore faudrait-il que la parfumerie soit considérée comme un art majeur, et là c’est pas gagné – autre sujet de débat.)
En tant qu’artiste la question de la nouveauté – plutôt du neuf – m’est cruciale. Il est un principe qui a longtemps régi l’acceptation ou non de l’artiste dans le champ de l’art contemporain : la condition de nouveauté. L’oeuvre d’un artiste est déclarée « bonne », et donc acceptée, si elle est neuve. Sans quoi c’est de l’artisanat. Or on a vu que toute oeuvre, si elle est toujours nouvelle, a de moins en moins la possibilité – mathématique – d’être neuve puisque toutes les possibilités ou presque sont explorées. (Voir l’article ici, sur la photographie et la musique, où le problème est récurrent…)
Pour sortir de cette impasse créative, j’en viens à me dire qu’il faut désormais considérer le neuf selon deux points de vues très distincts : celui de l’historien, et celui du consommateur. L’historien, contrairement au consommateur non spécialiste, connaît toute l’histoire. Il a en principe une vision totale, verticale et documentée, de ce qui a déjà été fait. Il attend la suite de la pile pour valider. Il attend, parfois longtemps, ce qu’il estime être neuf dans son domaine d’expertise (parfumerie, peinture, littérature, peu importe). Le consommateur, lui, n’a pas de vision globale, il débarque plein champ, à un moment donné. Il voit, il sent, ou commence à lire ce qui lui tombe sous la main ; s’il aime il achète, voilà tout. Peu lui importe que ce soit neuf ou pas : pour lui, hic et nunc, ça l’est.
Tout est neuf pour celui qui arrive.
Loin des balises de l’art officiel, l’accès à tout, tout le temps et depuis partout que permettent les réseaux a transformé le paradigme de la nouveauté : plus que jamais, toute rencontre peut être nouvelle. Toute rencontre – avec une création – peut être une première fois. Chacun son expérience, chacun son histoire.
Il n’y a pas si longtemps l’artiste devait passer les fourches caudines de l’Institution pour être déclaré « artiste officiel ». Les critiques et autres historiens d’art donnaient leur avis, vérifiaient surtout si la « condition de nouveauté » était respectée. Si oui, il entrait peu ou prou dans l’Histoire (Allez hop ! un de plus !).
C’est de moins en moins vrai, et possible, aujourd’hui.
Désormais, la voie du neuf étant saturée dans pas mal de domaines, l’artiste est libre. Il lui suffit de rassembler. De créer sa niche, son réseau et de croître, en proposant nouveauté sur nouveauté à des « gens qui arrivent », sans trop tenir compte de « l’Histoire ». Ce qui n’est pas forcément simple, ne nous emballons pas.
« Je vois nos institutions luire d’un éclat semblable à celui des constellations dont les astronomes nous apprennent qu’elles sont mortes depuis longtemps déjà. » (Michel Serres in Petite Poucette)
La prochaine fois je rentrerai plus dans le vif du sujet – la création de fragrances – en proposant une réflexion sur la morphologie « fréquentielle » des accords dans la musique et le parfum. Dissonance ou pas dissonance ? Harmonie quand tu nous tiens ;-)
(Mais là je repars en vacances, c’est terrible la vie d’artiste ! J’en ai profité, aujourd’hui si caniculaire, pour descendre toutes mes matières à la cave (huiles essentielles, absolues, CO2, etc.) car au-dessus de 25°C tout est bousillé, flingué par la chaleur. J’ai déjà perdu un vétiver de Haïti, je l’aimais beaucoup. R.I.P)